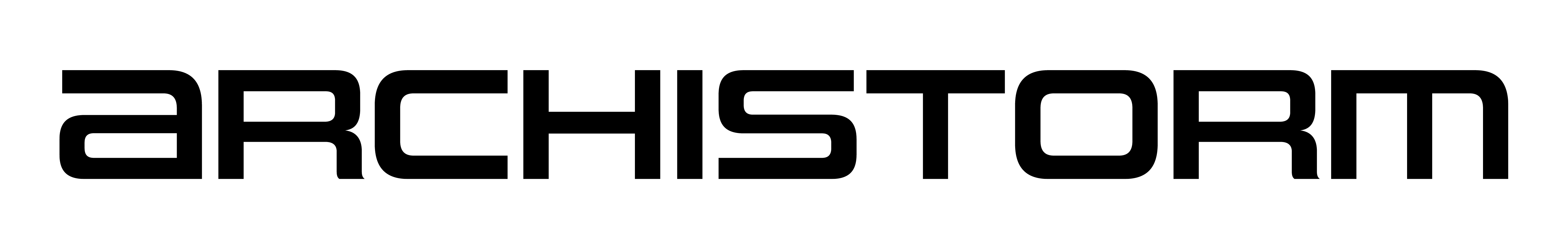DOSSIER SOCIÉTAL
Constructions nouvelles ou extensions d’institutions déjà célèbres, les musées n’ont cessé de fleurir depuis l’aube du XXIe siècle. Outils soumis aux stratégies de l’industrie culturelle, pour créer de la valeur économique et du dynamisme urbain, ces complexes d’art n’ont plus rien à voir avec les anciens lieux de contemplation et du savoir : ils ont pour objectif de mettre en place des dispositifs architecturaux et scénographiques à même d’attirer les visiteurs et de leur faire vivre une expérience physique singulière.
Depuis la politique de décentralisation culturelle en France, les musées connaissent une croissance continue et ils représentent de loin, l’activité culturelle favorite des français1. À l’échelle internationale, les chiffres sont éloquents : une enquête sur l’industrie muséale publiée par la société Artprice (numéro un mondial des données sur le marché de l’art) indiquait dès 2013 la naissance à venir sur les cinq années suivantes de 9 000 musées2, centres d’art et fondations. Comparativement, le XXe siècle présente au compteur la création de moins de 5 000 musées. Thierry Ehrmann, président fondateur de Artprice explique : « Le musée qui est né en Europe et principalement en France à la fin du XVIIIe siècle, a échappé dans un premier temps à toute logique économique, sa mission étant centrée sur la conservation des œuvres sous le regard de l’institution publique. ) […] ( La véritable révolution est venue principalement des États-Unis, avec notamment Peggy Guggenheim, qui a jeté les bases de l’industrie muséale au XXe siècle », et il poursuit « Au XXIe siècle, cette dernière est devenue un véritable secteur économique. Jamais la demande n’a été aussi importante pour visiter les nouveaux musées. La foule se presse en masse dans ces nouveaux lieux de consommation culturelle. C’est le pouvoir de l’art sur tous les continents ! », s’exclame encore Ehrmann, qui ajoute : « Aujourd’hui les entreprises, les industriels, les distributeurs, les hommes d’affaires, tous ceux qui ont réussi, créent ou envisagent de créer un musée, un centre d’art ou une fondation. C’est à la fois bon pour leur image, leur statut social mais c’est également vite rentable »3.

Une machine curatoriale
Un propos pertinemment illustré à travers la Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, implantée rue du Plâtre, en plein cœur du marais parisien, et inaugurée le 9 mars dernier. Initié de main de maître par Guillaume Houzé, Président de la Fondation, le projet « Lafayette anticipations » développe ses 2 200 m2 – dont 875 m2 consacrés aux expositions – dans un ancien bâtiment industriel classé, datant de 1891. La commande était ouverte : il s’agissait de donner forme à la flexibilité en aménageant des espaces d’exposition et de production d’œuvres artistiques. Un programme qui sied parfaitement à Rem Koolhaas à qui fut confié l’aménagement et qui théorisait dès les années quatre vingt dix l’instabilité programmatique des bâtiments. « Nous avons travaillé cet espace pour en ouvrir le champ des possibles », explique le créateur néerlandais qui est parvenu à la manière d’un orfèvre à concilier deux demandes contradictoires : la préservation patrimoniale et une flexibilité programmatique maximale. La cour centrale de l’édifice finement restauré accueille une tour de verre haute de 19 mètres, dont la structure métallique intègre de discrètes crémaillères. Quatre planchers mobiles y sont accrochés et permettent alors d’obtenir 49 configurations différentes du lieu. Art et architecture font ici œuvre commune venant ainsi contredire l’idée selon laquelle un espace de création contemporaine devrait être un espace neutre : « La typologie des espaces qui seraient acceptables pour l’art est très limitée à l’heure actuelle. Il n’y a pas de conflit ouvert entre artistes et architectes, bien sur, mais il y a beaucoup d’inhibition, une résistance sévère au sujet de ce qu’est une architecture pour l’art) […] (À mes yeux l’une des fonctions fondamentales de l’art pourrait précisément être d’explorer et de révéler les potentiels de l’espace », explique Rem Koolhaas4.
Texte : Sophie Trelcat
Visuel à la une : ©Lisa Ricciotti et Henning Larsen Architects
Découvrez l’intégralité de l’article au sein d’ArchiSTORM #90