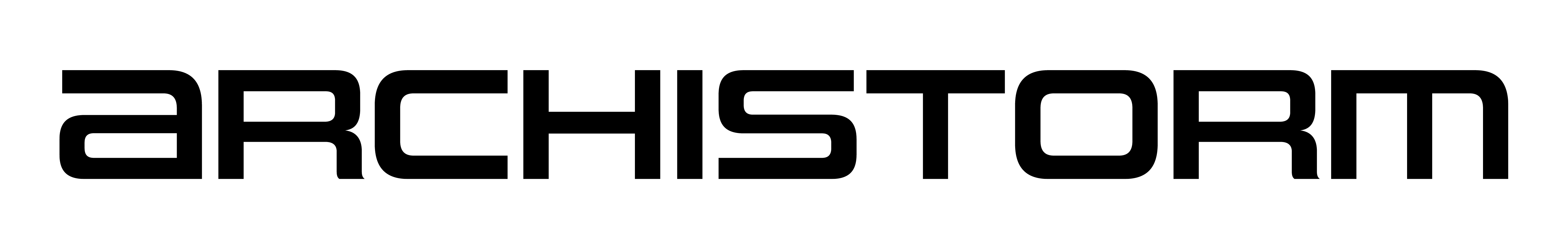Le pressing écologique, depuis vingt ans, pèse lourd sur la conception architecturale. Comment, à la fin, entrer dans l’ère post-carbone du bâtir ? Ne rêvons pas : toutes les normes HQE (« Haute Qualité Environnementale ») et assimilées, tous les chantiers propres, toutes les bonnes intentions « vertes » clamées paume de la main sur le cœur n’y suffiront pas.
S’agissant de réduire l’empreinte carbone, le recours à une architecture faite de végétaux, « à l’archaïque » donc mais actualisée, n’est pas en revanche la pire option. S’il convient bien, en l’espèce, de prendre en compte dans ce choix les parts respectives du consensus (important), de la mode (non moins importante) et de l’efficient (moins convaincant), le fait est : l’appel au « No More Concrete », plus jamais le béton, se soldera à terme par une croissance soutenue de l’architecture végétale.
Non de manière fatale, il est vrai. La rénovation immobilière, plus systématisée aujourd’hui, le réemploi des matériaux, toujours plus usité, l’extension et l’isolation des bâtiments existants, le croît des bâtiments à énergie passive, le frein mis aussi à l’artificialisation (qui continue bon train cependant), n’impliquent pas la péremption des modes conventionnels de construire. Le fait est, cependant : recourir aux végétaux, à commencer par le bois, le bambou, le chaume ou la paille, est à présent dans l’air du temps. Non selon le modèle immémorial légué par le Paléolithique supérieur et le Néolithique, et en cours encore chez certaines populations rétives au progrès, celui de la hutte de branchages ou du palais fait de poutrelles (le tronc comme bois d’œuvre, directement et sans travail du matériau). Le modèle en cours dorénavant, en lieu et place, et âge « 3.0 » oblige, est celui, amplement rénové, de l’architecture végétale de haute technicité.
Construire « naturel », une culture bientôt assise
L’architecture recourant aux végétaux s’inscrit depuis la Préhistoire dans un cycle durable, continu et que jamais n’a périmé le quotient croissant de technologie appliqué à la construction. La modernité, si l’on en doutait, compte ainsi une multitude d’architectes du bois, d’un talent indéniable et aux réalisations crédibles. Alvar Aalto en Finlande, Junzō Sakakura au Japon ou encore Roland Schweitzer en France, parmi tant d’autres, font valoir tout l’intérêt qu’il y a à bâtir « naturel », la construction de type Timber n’étant toutefois pas exempte de récriminations en termes écologiques (traitement chimique des matériaux, recours à des colles polluantes…), aurait-elle a contrario d’indéniables avantages dans certains cas ou lieux : songeons à la résistance du bois aux typhons et aux tremblements de terre, à la facilité qu’il y a à le travailler et à le transporter (sur les fleuves, notamment) ou encore à sa capacité d’absorption de l’humidité. En 1985, Roland Schweitzer livrait à Châlons-en-Champagne le bâtiment tout de bois de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt. Édifice classique par la forme et les proportions, de type néomoderne que celui-ci mais béton-zéro, boisé du sol au plafond et aux murs. Ce chalet géométrisé, à son heure, représenta une véritable réussite en termes matié- riste, spatiaux et de confort, étant bien entendu, grincera-t-on à toutes fins de modérer l’enthousiasme, que le bois ne saurait être le matériau parfait. Ainsi de sa durée de vie, même après traitement autoclave classe 4 (garantie de 10 ans avant pourrissement, pas plus), et de sa dynamique matérielle propre : le mécanisme d’extension-rétraction qui le caractérise, dépendant de la température et de l’hygrométrie, engendre à l’occasion pour l’oreille, le soir et la fraîcheur venus, de fort disgracieux craquements faisant écho au concert des crapauds autour de la mare voisine.
L’âge écologique de l’architecture, consacré avec la fin du XXe siècle sur fond de prise de conscience élargie de la dégradation environnementale, engendre une relation nouvelle au végétal. Cette fois, ce dernier n’est plus seulement envisagé comme gros œuvre, comme matériau de construction mais, toujours plus, comme un compagnon du bâti, comme cette matière sœur qui vient donner de l’air (voulu pur) à la construction. Rappelons l’offre à Hanovre par Thomas Herzog, dans le cadre de l’Exposition 2000, d’un magnifique pavillon de bois au toit très aérien. On se souvient aussi, parce qu’il a fait date, de l’« Immeuble aux bambous » qu’Édouard François plante aux Batignolles, à Paris, au début des années 2000. Ce bâtiment au fond très ordinaire, une tour béton à plateaux comme on en comptera bientôt des dizaines dans ce périmètre en complète restructuration, se voit affublé de pots contenant des bambous sur l’ensemble de ses terrasses et à tous ses étages, de façon périphérique. Le succès est réel, en termes médiatiques du moins : l’« Immeuble aux bambous », à son heure, fut beaucoup « publié » et photographié. Une visite sur site, cela posé, douche l’exaltation. Les bambous, notoirement, font obstacle à la visibilité et à la lumière. Se présentent-ils comme une alternative vertueuse à la mode d’alors, celle des exo-résilles (une enveloppe métallique ou de verre plaquée sur l’enveloppe même du bâtiment, percée comme un gruyère de trous à la géométrie fractale, servant prétendument de brise-soleil mais gâchant en réalité, pour l’usager, la vue sur l’extérieur), l’apport que concrétisent les végétaux reste ici plus anecdotique que sensible. Oxygénation ? Minimale. Mise en forme concrète d’un symbiotisme humain-
végétal ? Pas garanti. Un acte symbolique bienvenu, assurément, mais un décor aussi et surtout. Où retrouver une fois encore, en dépit d’intentions respectables, ce bon vieux Kosmeticos qui s’apparente à l’art du fardage, un vert-à-lèvres pour une architecture aspirant à tout crin mais sans grand moyen efficace à la qualification écologique.

Académie rénovée des Sciences de Californie
Le vrai, contre le rêvé et le factice
Orner les bâtiments de plantes jusqu’à en faire dans certains cas des analogons de la forêt jardinée ou presque ? Il faut en la matière séparer le bon grain de l’ivraie. Le bon grain, c’est Friedensreich Hundertwasser, sa Hundertwasserhaus viennoise (1985) et ses jardins intégrés à son bâtiment, dans le cadre d’une plantation de végétaux murale et de toit (253 arbres…) sinon anarchique, du moins censée devoir être laissée à sa croissance propre, sans intervention humaine (ce qui s’est avéré impossible, dans les faits : verdure invasive et racines destructrices, plus des problèmes d’écoulement des eaux…). L’ivraie, ce sont en contrepartie ces projets de végétalisation à tout crin qui font florès à compter des années 2000 et qui semblent être un passage obligé des concours qui se veulent gagnants.
Pas de toit planté d’herbe, de sauge, de frênes ou d’espèces férales dans votre projet d’hôtel des impôts ? Perdu d’avance ! Prévoyez au moins un mur végétal signé Patrick Blanc, à l’image des flancs sur Seine du Musée parisien du Quai Branly-Jacques Chirac. Si ce n’est guère efficace au titre de la rentabilité écologique, du moins est-ce particulièrement bien vu du Boboland, ce royaume d’écologistes de parole. Cela sans dire un mot des vues sur l’avenir « verdi » que proposent alors nombre d’architectes visionnaires ou expérimentaux, dans l’esprit des rêveries sur les villes végétales d’un Luc Schuiten, théoricien de l’« archiborescence » et créateur de la maison autonome Oréjona (1977), écologiquement vertueuse et en large partie faite de bois. Paris en 2050 reconfiguré par l’esprit libre de Vincent Callebaut, de la sorte, se transfigure en une immense forêt verticale où le solide de la pierre, du fer et du verre vient composer en équilibre avec le tendre des plantes, en un projet à la fois merveilleux et souhaitable, fantasque certes, mais attendu sans délai. L’imagination au pouvoir, soit
– mais le réel ?
Il convient bien, en l’affaire, de faire leur part, respectable celle-là, aux projets ou aux réalisations qui font du végétal l’allié sincère de l’architecture, plus que sa seule caution « verte ». Renzo Piano, avec son Académie rénovée des Sciences de Californie à San Francisco (2008), a droit, à ce registre, à citation, et pour le mieux. La part du végétal, concernant ce bâtiment légitimement primé, est efficiente : « La terrasse de l’immeuble, surface ondulée de 10 000 m2 en hommage aux collines de San Francisco, est couverte d’1,7 million de plantes indigènes (…). Ce « toit vivant » sert à refroidir l’intérieur du bâtiment, il collecte environ 13 millions de litres d’eau par an, en grande partie réutilisés par le musée » (source Wikiarquitectura). On dira également plus qu’un mot, à la même aune, de l’Eden Square conçu pour la ville de Rennes, en 2012, par Christian Hauvette, pour la circonstance le premier ensemble immobilier français (mondial ?) intégré à une serre végétale. Cette réalisation est ainsi sobrement présentée par l’agence de l’architecte français : « 87 logements en accession et serre bioclimatique, place des Neuf-Journaux, ZAC Rives du Blosne, Chantepie (Ille-et-Vilaine). Surface : 7 390 m² SHON ». Eden Square, entre les réalisations toujours inventives de Christian Hauvette, reste, conçue peu de temps avant que la mort ne le frappe brutalement, son authentique chef-d’œuvre. Le programme y consiste à réaliser une petite centaine de logements « bioclimatiques » à énergie positive et empreinte carbone minimale. L’heure est alors, officiellement, au HQE, exigence normative qui nécessite des architectes la plus grande vigilance écologique. Le projet de Christian Hauvette, débordant la norme (trois dérogations ministérielles vont être indispensables pour acter le permis de construire), consiste à installer, sur un plan en carré, un habitat autour d’une serre végétale centrale, grand vide intérieur planté jouant le rôle de poumon vert. « Au centre d’un bâtiment-îlot, aux lignes épurées et graphiques, se cache un doux jardin, lové dans une serre. Une œuvre architecturale à la fois audacieuse et poétique qui relève le défi de l’écoresponsabilité. Une première en France en matière d’habitat collectif ! », clame la promotion, sans exagérer (documentation du Groupe Launay, 2019). Manifeste pour le développement durable, Eden Square offre du vert mais aussi du solaire et des isolations naturelles faisant de ce programme un prototype des habitats Green qui fleurissent aujourd’hui partout.
L’idéal du « tout naturel »
Une architecture cooptant le végétal est, en perfection, une architecture vivante. Comprendre, qui permet au matériau naturel la possibilité de vivre sa vie, hors toute contrainte. C’est évidemment, regrettons-le, moins possible qu’espéré. Si l’on peut laisser les plantes d’un mur ou d’un toit végétalisés pousser à leur rythme, le peut-on du tronc d’un arbre qui servirait de poteau-poutre à une maison ? Construire végétal n’est pas laisser toute sa liberté au végétal, c’est à la fois contraindre celui-ci (gros œuvre) et lui laisser libre cours (aménagement, isolation, drainage des eaux, décoration).
Certains projets, au su de cette double occurrence, utilisent ainsi le
végétal de façon combinée et solidaire, en mode contraint pour la cons- truction même des bâtiments, et en mode libre pour leur environnement. L’un des exemples les plus signifiants est le Green Village de la designeuse Elora Hardy, conçu en Indonésie, à Bali, Mecque de la construction en bambous, avec le périmètre de maisons parfois spectaculaires et d’un haut degré de confort en cette zone tropicale au climat éprouvant. Dans la lignée de ses parents, des écologistes militants qui y ont créé une Green School, Elora Hardy met en place, au début de notre siècle, son projet Ibuku de valorisation de la construction en bambou. Il en émane bientôt le Green Village, ensemble de demeures luxueuses toutes de bambou conçues et construites pouvant se targuer, au registre qualitatif, de cocher les cases de la sobriété, du renouvelable et de l’éco-responsabilité. De façon plus que symbolique, cet habitat strictement « vert » baigne dans un environnement saturé lui aussi de verdure, où le bambou, là encore, règne en maître. Végétal contraint plus végétal libre, dans cet ensemble vertueux, jouent une partition harmonieuse, peu suspecte de prodiguer la pollution, sinon celle-ci, de plus en plus supportable, la pollution chlorophyllienne.
À suivre : Architecture et végétaux 2 – Concrétisations vertueuses
Par Paul Ardenne
Visuel à la une : Académie rénovée des Sciences de Californie, San Francisco, Renzo Piano, 2008 © Tim Griffith
— Retrouvez l’article dans Archistorm 130 daté janvier – février 2025