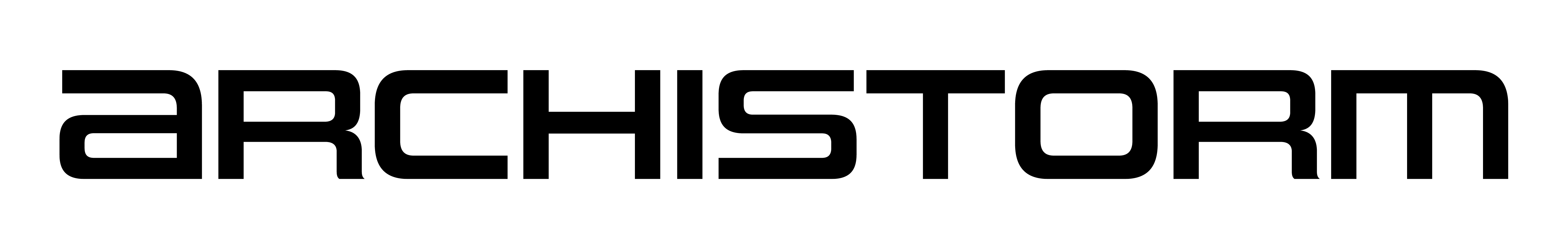Les deux expositions consacrées en 2024 aux grands magasins ont montré à quel point ces programmes furent des terrains d’expérimentation et d’innovation : commerciale, mais aussi spatiale, technique et esthétique. La mise en couleur d’une façade pour les Galeries Lafayette, en 1912, fait partie des gestes oubliés de cette histoire marquée par les modes et le renouvellement. Elle est désormais restaurée et évoque les aspirations d’une génération d’architectes amateurs de polychromie.
On doit à Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra (1861-1875), l’un des premiers manifestes d’un Paris pittoresque et coloré, dans son ouvrage À travers les arts, paru en 1869 : « […] je m’imagine le jour où les tons fauves de l’or viendront piqueter les monuments et les constructions de notre Paris ; je m’imagine les tons chauds et harmonieux qui frémiront sous le regard charmé. […L]es fonds des corniches reluiront de couleurs éternelles, les trumeaux seront enrichis de panneaux scintillants, et les frises dorées courront le long des édifices ; les monuments seront revêtus de marbre et d’émaux, et les mosaïques feront aimer à tous et le mouvement et la couleur. Ce ne sera plus le luxe faux et mesquin ; ce sera l’opulence, ce sera la sincérité. »
Marqué par le croisement de l’Art nouveau, du rationalisme pittoresque et de l’éclectisme monumental, le Paris de 1900, lui, fut peut-être le plus coloré de l’histoire. La couleur, au demeurant, n’était pas le seul agent de cette animation des façades prônée par Louis Bonnier, auteur du nouveau règlement de voirie en 1902 et décidé à en finir avec la ville régulière, incarnée par la rue de Rivoli puis les percées haussmanniennes : la sculpture a aussi amplement participé de ce projet d’animation de la rue et d’individualisation de l’immeuble. Avec l’Art nouveau et ses céramiques émaillées, la couleur s’affranchit alors de la structure au profit de la façade ; et bien qu’elle ne lui soit pas totalement liée, cette approche est contemporaine d’un autre phénomène : l’emploi de plus en plus massif du béton armé dans la construction, un matériau qui lui-même va susciter une réflexion spécifique sur la notion de parement coloré. Une innovation technique en rencontre une autre avec le développement des grès flammés, plus particulièrement ceux d’Alexandre Bigot. Par son mode de cuisson, le grès présente la qualité de produire des couleurs moins violentes que la faïence ; il a en outre cette faculté, plus précieuse encore, d’être quasi inaltérable. Avant que ne domine la firme de ses anciens collaborateurs Alphonse Gentil et Eugène Bourdet, Bigot fut le principal artisan de la coloration parisienne avant 1914. On lui doit aussi bien les motifs à connotations érotiques de son propre immeuble, 29 avenue Rapp (7e, 1900), dont il confie la construction à Jules Lavirotte, les efflorescences du 14 rue d’Abbeville (10e, Édouard Autant, 1901) que les sobres feuillages du 25 bis rue Benjamin-Franklin (16e, 1903) des frères Perret. Dans ce dernier immeuble, c’est la totalité de la façade qui fait l’objet d’un habillage de grès, ce qui n’empêche nullement une distinction nette, presque pédagogique, entre éléments porteurs et non porteurs. Réalisés par Émile Müller, cette fois, les grès du 9 rue Claude-Chahu (16e, Charles Klein, 1903) se distinguent par leurs motifs de chardons, expression parmi d’autres d’une présence végétale qui n’a rien d’anecdotique.
Tandis qu’Henri Sauvage poursuit cette histoire en optant pour un revêtement intégral inspiré des travaux d’Otto Wagner – tantôt avec les carreaux de faïence de la firme Boulanger, tantôt avec les céramiques de Gentil et Bourdet –, c’est aussi par la peinture que Ferdinand Chanut traite la façade des Galeries Lafayette élevée sur la rue de la Chaussée d’Antin (1911-1912). L’architecte, alors directeur du service d’architecture et des travaux du grand magasin, la réalise en même temps que la spectaculaire rotonde intérieure coiffée d’une coupole en verre polychrome. L’objectif de cette campagne de travaux est d’étendre le magasin en cœur d’ îlot et d’unifier l’espace en créant des volumes et un décor inspirés des bazars orientaux. Dans cet esprit, la façade doit agir comme un signal et attirer le passant vers l’intérieur du magasin. Unique en son genre dans le paysage parisien, elle vaudra à Chanut d’être primé au concours des façades de la Ville de Paris, en 1913.
La façade est composée de trois étages et de trois travées, chacune couronnée par un arc sommital. La structure est une ossature métallique ancrée dans la trame en béton armé du magasin, qui porte un parement de pierre calcaire sculptée de motifs végétaux et géométriques ouvragés. La toiture, qui s’étage en gradins en profitant du profil permis par le règlement de 1902, est entièrement recouverte de carreaux de céramique et de mosaïque peints ; un décor qui s’est considérablement appauvri au fil du temps, lavé par la pluie et la pollution atmosphérique. En outre, les Galeries Lafayette ouvrent en 1930 un concours en vue d’agrandir le magasin et d’unifier ses façades. Parmi les concurrents à cet exercice de camouflage, on trouve alors deux des maîtres de l’Art déco français, Henri Sauvage et Pierre Patout, mais aussi les frères Perret. Le premier venait de montrer son savoir-faire à la Samaritaine et le deuxième allait remporter la consultation, sans réaliser pour autant la totalité de son projet. L’architecture de style paquebot livrée par Patout en 1932 amputera cependant celle de Chanut d’une travée, avant que Jean Démaret ne lui superpose, en 1958, une construction de plusieurs niveaux.
En 2023, l’agence GFTK (Marie-Amélie Tek et Romain Greif) engage des études sur la base d’une observation fine des clichés anciens, qui révèlent au moins trois tons différents appliqués au décor sculpté : les fleurs et les feuilles sont de teintes claires, les perles et les roses se démarquent avec plus de densité, enfin l’or illumine l’ensemble. Le dernier ravalement opéré en 2006 a hélas effacé les ultimes vestiges de polychromie, à l’exception de quelques traces d’ocre et d’or dans les creux. L’analyse minutieuse du décor intérieur du magasin, en parfait état, a néanmoins permis de restituer, par analogie et comparaison, toutes les couleurs de la façade. Avant cela, de nombreux essais préalables de mise en teinte ont été réalisés à même le mur, tout au long des phases de l’étude, par tous les temps, et observés sous l’incidence de toutes les lumières. La maçonnerie de pierre sous-jacente a été restaurée et consolidée, entraînant au passage des reprises structurelles importantes de l’ossature métallique. Les ouvrages remarquables tels que les décors de mosaïque, les ferronneries, les huisseries, ont été conservés et restaurés dans leurs dispositions d’origine le plus souvent. Certaines parties altérées ou manquantes ont été restituées et réintégrées. Les rampants de toiture ont été nettoyés et la polychromie des céramiques ravivée. Les menuiseries extérieures ont été remises en jeu, repeintes et réparées. Les grilles de ventilation, elles, ont été repensées pour s’intégrer uniformément dans cette composition cohérente.
Après la façade de l’Opéra, dont la restauration en 2000 avait révélé la variété des matériaux, après la salle Labrouste à la Bibliothèque nationale de France en 2016, cette restauration d’une polychromie manifeste est l’occasion de rappeler combien la couleur a fasciné les architectes du XIXe siècle et du début du XXe. Contemporaine du théâtre des Champs-Élysées, qui a marqué les esprits par son éclatante blancheur, la façade « byzantine » de Chanut reflétait une conception plus éclectique ; après-guerre, le croisement des deux approches donnerait certaines des œuvres les plus originales de l’Art déco.
Par Simon Texier
Visuel à la une : © Ferdinand Chanut, coupole des Galeries Lafayette, 1912
— Retrouvez l’article dans Archistorm 130 daté janvier – février 2025