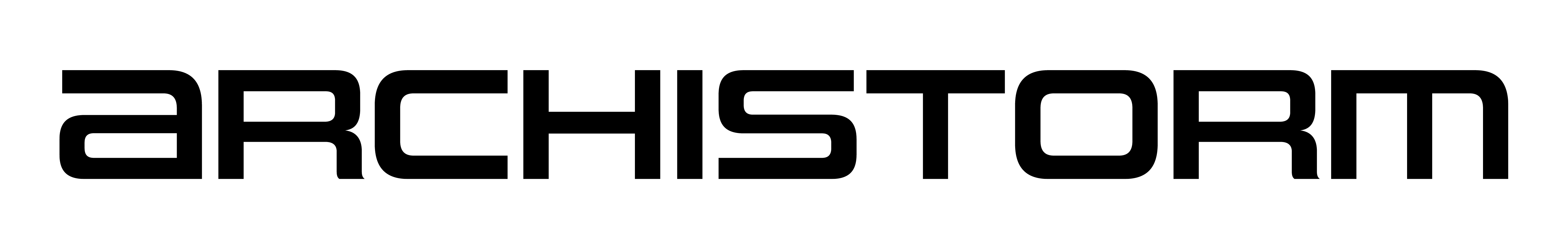BLOCKBUSTER
« Du village Lacustre aux villes flottantes »
Le billet d’humeur de Paul Ardenne
En matière d’habitat, les relations entre l’homme et l’eau sont immémoriales. L’humain, depuis ses origines, goûte de s’installer sur les rives humides. Les trois quarts des populations premières vivaient, ou le long des fleuves et des lacs, ou en bord de mer ou d’océan. Par nécessité, l’homme ne pouvant exister sans le croisement constant entre lui-même et l’eau : celle que l’on boit, celle aussi où l’on pêche et l’on se lave, celle que l’on utilise pour irriguer les cultures, celle où l’on se met à l’abri des prédateurs, encore, à l’image des peuplades lacustres de l’âge de bronze.
Le temps passant, les zones côtières en tous genres évoluent, pour le pire. Habitat saturé, surexploitation des rivages, nivellement touristique, pollution endémique, sans oublier le réchauffement climatique qui vide peu à peu certaines côtes maritimes. Ajoutons-y, dernier en dates des fléaux affectant l’univers liquide, le « seasteading ». Ce nouvel habitat, confisqué par les seuls Terriens très riches, consiste à créer des villes flottantes isolées de la gueuserie universelle.
- VIVRE LIQUIDE
- LES OCÉANS, NOUVELLES FORTERESSES
Le meilleur indicateur de l’attraction des bords d’eau est fournie par le marché immobilier. Portons-nous dans l’archipel d’Hawaï, au cœur de l’océan Pacifique, une des zones les plus touristiques au monde (moins de deux millions de résidents pour huit millions de touristes chaque année). Hawaï, devenu en 1959 le 50e état des États-Unis, connaît depuis lors un boom touristique intense. Le goût combiné pour le lei, célèbre collier de fleurs local, la hula et le ukulélé, sans doute, peut expliquer ce succès, le folklore et la quête d’exotisme étant de bons géniteurs du tourisme. Le soleil quasi permanent et l’omniprésence de l’océan, plus sûrement, y sont les véritables aimants. Si l’archipel d’Hawaï, composé de quatre îles principales, ne compte pas les plus belles plages du monde (ce qu’il doit à sa nature volcanique et aux sols de lave, mal praticables, bordant nombre de ses côtes), celles-ci ont pour avantage, à l’exception d’Honolulu, de n’être jamais saturées. Parlons argent. Le tourisme, en ces lieux, a son prix, plutôt élevé, il tient à distance les bourses plates et réserve à qui en a les moyens les meilleurs spots, sous forme de resorts luxueux ou de villas les pieds dans l’eau. Une maison de taille moyenne en bord de côte, c’est un investissement minimal d’un million de dollars, voire plus souvent le double ou le triple. La même en retrait de la côte, c’est trois fois moins.
Un univers porteur de dissidence

Projet d’habitation off-shore © Jacques Rougerie Architectes Associés
Inutile de rappeler dans le détail quelles sont les plaies du tourisme, et particulièrement du tourisme balnéaire. Outre défigurer le paysage (de Miami Beach aux côtes thaïlandaises, espagnoles, marocaines, uruguayennes…), celui-ci modifie intensément l’économie sociale des lieux qu’il affecte. Bénédiction pour les tour-opérateurs, les promoteurs et les commerçants, le tourisme est au contraire une malédiction pour les « locaux », les résidents de longue durée. Hausse générale des prix, restriction de l’économie aux activités d’accueil, de divertissement et de plaisance, hausse des trafics en tous genres… Confrontés à une telle évolution, les « locaux » n’ont le plus souvent qu’une seule alternative, vider la place, porter leur habitat autre part, en des lieux moins surdéterminés et moins onéreux au quotidien. Même lorsqu’ils officient dans l’industrie du tourisme, au demeurant. Le personnel des grands hôtels de Cancun a sa ville propre, à quelques kilomètres du cordon dunaire qui fixe l’économie balnéaire. Mouvements pendulaires matin et soir, pour se rendre au travail et en revenir.
Au regard de l’urbanisme, l’aménagement balnéaire se structure selon le principe du suivi rigoureux de la ligne côtière, et tout ce qui se trouve à plus de quelques centaines de mètres du bord de l’eau cesse de le concerner. Il en résulte un effet de télescopage souvent brutal entre habitat côtier, privilégié, et habitat à distance des côtes, laissé pour compte au beau milieu ou au-delà des infrastructures (autoroutes, ponts, voies ferrées…) permettant l’accès aisé au littoral. Le complexe bâti de type marina, sur le modèle de la plus célèbre d’entre elles, Port Grimaud (1966, François Spoerry), formule pionnière établie dans le midi de la France, en est la meilleure illustration. Conçu peu ou prou comme une gated city, une unité urbaine fermée, ce type de quartier côtier segmentant tout à la fois le paysage, la vie sociale et l’économie locale se signale par sa pulsion pleinement assumée à la dissidence sociale. Petite Venise occupant le fond du golfe de Saint-Tropez, Port Grimaud, cité lacustre régie en copropriété, ne reprend rien de l’écosystème sur lequel elle est implantée, la zone marécageuse de la Giscle où on l’établit faisant les frais de sa fondation. Le principe d’isolat qui préside à l’existence de la marina (constituer l’équivalent d’un nid, d’un monastère balnéaire) l’emporte sur toute autre considération. Ici, le résident peut et doit faire l’expérience de sa différence, de sa singularité irréductible, au sein d’un milieu qui a coupé les ponts avec son environnement.
Cet effet de télescopage physique, de dichotomie architecturale et sociale ne se voit jamais mieux que lorsque l’activité balnéaire en vient à décliner. Un exemple brutal en a été donné récemment, entre le début du Printemps arabe (2011) et la fin des années 2010, par la Tunisie, pays où le tourisme représente d’ordinaire un quart des revenus voire bien plus dans les zones touristiques. En moins de deux années, agitation politique et terrorisme y vident les côtes de leurs touristes. Des zones entières, à Hammamet, à Sousse…, voient les complexes touristiques fermer. L’abandon des espaces côtiers, spectaculaire, n’en rend alors que plus flagrante l’existence de deux systèmes urbains, de deux systèmes économiques, de deux formes de vie, avec l’eau d’une part, à côté de l’eau d’autre part.
De l’utopie au concret
Indépendamment des vicissitudes de l’Histoire ou du marché, une donnée s’avère constante en termes de villégiature ou de culture vacancière ou distractive : l’eau, quoi qu’il coûte d’en être au plus près, est un besoin croissant. L’art de la plage, de la promenade et de la randonnée, le goût pour les jeux de glisse et de vent, l’appétence pour les panoramas, tous ensemble, forment un soluté auquel il paraît difficile de résister. Le bonheur de l’amateur d’eau, pour autant, a toutes les chances de se racornir au vu d’une donnée devenue aussi incontournable que pénible, l’encombrement. Fréquentation entre happy few, cela passe. Sur-fréquentation de masse, cela casse. Pour qui tient à tout prix à l’isolement, ne reste dès lors qu’une possibilité, quitter le bord d’eau, se porter au plus loin de la côte. (…)

Carte Utopia (1595-1596) d’Abraham Ortelius, représentation visuelle que le cartographe a faite de l’Utopia de Thomas More
Visuel à la une : Cancun et son littoral © Dronepicr
Retrouvez l’intégralité du billet d’humeur de Paul Ardenne dans le numéro 96 du magazine Archistorm daté mai – juin 2019 !