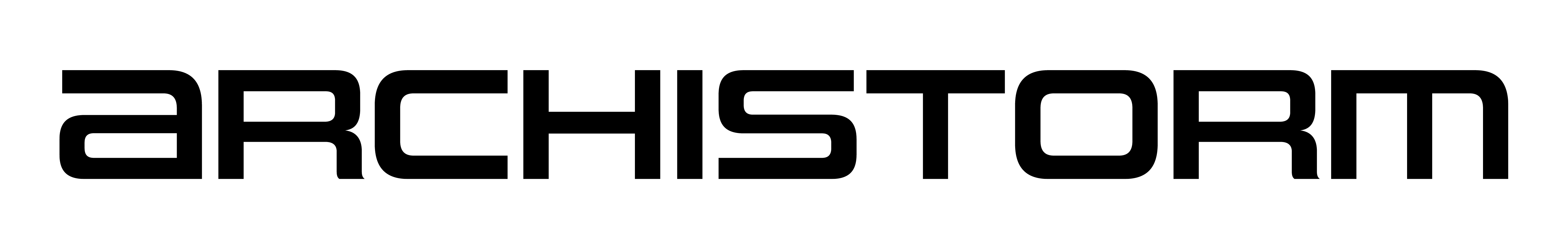BLOCKBUSTER
L’ARCHITECTURE FIN DU MONDE
2. L’ALTERNATIVE SURVIVALISTE — OU SAUVAGE, OU MORT
Vivre dans un bunker, même le mieux équipé et doté qui soit, a cet inconvénient : tôt ou tard, il faudra sortir, se confronter sur leur terrain même à la fin du monde et à l’apocalypse. Où le survivalisme marque un point, c’est au nom de ses pouvoirs d’adaptation, et d’adaptation superlative. Quelle que soit la situation désastreuse à endurer, il y prépare ses adeptes.
Le survivalisme, devenu à la mode dans les années 1960, sur fond de crainte d’une Troisième Guerre mondiale nucléaire, c’est, en résumant, la vie paléolithique, celle de nos grands ancêtres avant que l’âge néolithique n’en fasse des sédentaires, des agriculteurs, des éleveurs, des villageois, puis des urbains. La vie sauvage, pour le dire autrement. Le survivaliste, c’est ce nomade qui vit caché, dans la nature profonde si possible, et qui prospère de ce qu’il chasse, pêche, cueille et vole si besoin est. Son habitat — il lui en faut un malgré tout — est spécifique, réglé par ces trois principes : simple à bâtir, pratique, élémentaire.
L’abondance n’a pas toutes les vertus. La petite musique sombre, entêtante, qu’elle fait parfois tintinnabuler dans nos têtes est celle de la pénurie. Et si d’un seul coup tout venait à manquer ? Et si demain il n’y avait plus de vivres, plus d’électricité ni de pétrole, plus de structures sanitaires, plus de transports ? Un ange passe, médusant, doublé d’un vilain frisson parcourant nos échines.

L’état de pénurie, avec l’âge néolithique, s’est fait moins présent : l’amélioration des techniques de chasse et de pêche, l’élevage et l’agriculture pourvoient bientôt à l’essentiel des besoins, au premier chef alimentaires et vestimentaires. Habitabilité et qualité des lieux de vie, elles aussi, s’améliorent, de la hutte sans commodités au gratte-ciel suréquipé en confort, tandis que progressent les transports et qu’un réseau de communication densifié maille les villages puis les villes. En quelques courts millénaires (une paille, si l’on considère que l’espèce homo a plus de cinq millions d’années d’âge), on passe de la vie où tout manque, perlée de rapines, de famines et d’épidémies mortelles (« De la guerre, de la faim, de la peste, délivre-nous Seigneur »), à une ère où l’on possède tout en trop, éclatante de richesse matérielle, de surproductions en tous genres et d’oubli graduel des calamités, surmontées l’une après l’autre. Passage d’une vie de malheur à une vie de cocagne, de plein bonheur satisfait ? Ce serait le cas si l’abondance, à force de se faire surabondante, n’engendrait pas ces travers devenus systémiques que sont la surpopulation, la surconsommation, l’épuisement des ressources disponibles, la contamination du monde par les polluants, la tyrannie anti-écologique en diable que l’humain repu impose à son environnement. Le « plein vital » (comme on dit le plein emploi), s’il est une réalité acquise, est de fait une réalité fragile. Tout ou trop posséder implique que nous pouvons tout perdre faute d’avoir été suffisamment attentifs à la gestion des ressources et à la bonne distribution entre exploitation du monde et conditions de vie durables.
Le sentiment survivaliste naît de l’hypothèse, hautement probable, d’un clash, d’une déflagration matérielle résultant de cette conduite insouciante et irresponsable. Pessimiste sans aucun doute, mais à bien des égards réaliste, il met l’individu des temps de cocagne devant la possibilité de la ruine globale, du manque général et de la nécessité de devoir survivre au collapse qu’il aura contribué à créer. Rien d’inconséquent, tout bien pesé. (…)
Texte Paul Ardenne
Visuel à la une Aménagement d’une cabane en Californie © Toa Heftiba
Retrouvez la partie 1 de cet article ici
Retrouvez l’intégralité de l’article dans le daté Septembre-Octobre d’Architsorm