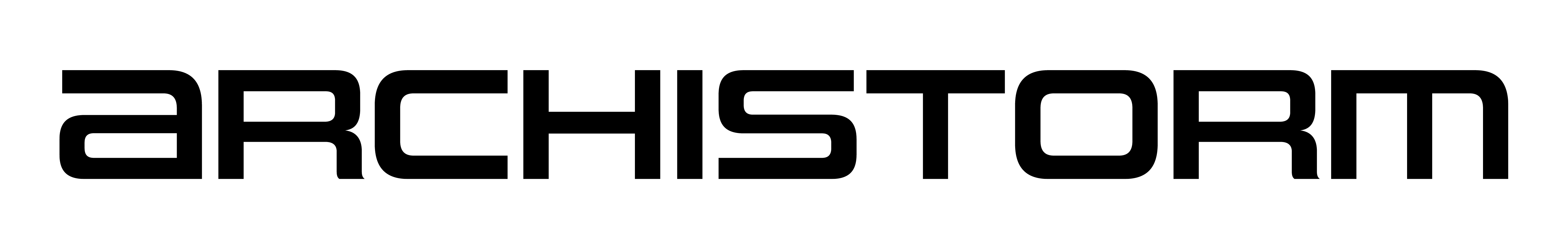Le lexique de l’architecture n’est pas totalement immuable. À chaque décennie, son « bon » mot. Les années 2010 : « réinventer ». Les années 2020 : « transformer ». Entre ces deux verbes, la « frugalité » a trouvé un écho favorable – peut-être jusqu’à l’excès – auprès d’une profession autant que la « bienveillance » ou le « réemploi ». Cependant, sont-ce là des termes désormais inaudibles à force d’être répétés à l’envi ? Difficile toutefois de s’en passer… « Au début était le verbe », écrit-on volontiers en tête de quelque prologue. Alors que faire ? Les mots sont là pour dire les choses. Toutefois en sommes-nous certains ? S’agit-il d’un vernis sémantique ou d’une utile désignation ? L’agitation permanente des signifiants et des signifiés, plus encore excitée par un idéal de communication, laisse planer le doute.
Pour Louis Téqui, l’heure n’est pas à la critique. L’architecte observe son temps et prend soin de se détourner de tous ses réflexes rhétoriques. Son vocabulaire ne convoque ainsi aucun de ces concepts rendus valides par l’actualité des meilleurs discoureurs. Pour autant, il faudrait savoir parler d’une pratique. Mieux, la caractériser… et par conséquent lui trouver un ou plusieurs mots.
(…) Extrait de l’éditorial par Jean Philippe Hugron
Louis Tequi, l’économie de la valorisation
Extraits de l’entretien
Pourquoi choisir le verbe « patiner » plutôt que « vieillir » ? Pourquoi ne pas souhaiter tout simplement que les projets vieillissent bien, par exemple ?
LT : Se patiner est une manière de vieillir. Je crois qu’une bonne architecture est celle qui après 10, 15, 20 ou 30 ans n’inspire aucun dégoût car elle vieillit bien. Mieux, parce qu’elle se patine. Parce qu’elle absorbe les affres du temps sans difficultés ni dysfonctionnements. Pour durer, un projet doit également rester aimable à l’égard de son environnement. Il doit toujours donner envie, bien des années après sa livraison.
Aussi, je me méfie de la mode, de l’effet waouh… peut-être même de l’art contemporain et de son goût immodéré pour les concepts. Ce dernier me semble réservé à une élite sachante tout en étant une affaire de spéculation. Je note, dans ces circonstances, une perte de sens, source d’une incompréhension collective. L’architecture contemporaine emprunte ce chemin depuis plusieurs décennies. Il faut pourtant faire attention à cela. Que ce soient la patine, la matérialité ou encore le caractère aimable d’un bâtiment, tous ces thèmes concourent au même objectif : la pérennité. L’art contemporain me semble davantage ancré aujourd’hui dans la consommation et l’éphémère…
Du « manque d’expression » à « l’archaïsme », comment abordez-vous la question esthétique sous-jacente à tout projet d’architecture ?
LT : Je formule la question différemment : comment faire aujourd’hui pour aller vers le dénuement ou le dépouillement sans tomber dans l’appauvrissement de l’architecture ? Je ne souhaite pas aller vers le sommaire. Il nous faut développer l’ensemble des détails qui assurent la pérennité d’un ouvrage. Son « esthétique » est l’un des moyens de sa bonne compréhension et de sa parfaite appropriation. Avec le temps, cette dernière devient un « attachement ». Mon souhait le plus cher est que ceux qui vivent ou pratiquent les projets développés par l’agence s’y sentent profondément « attachés ».
(…)

Maison d’accueil rurale pour personnes âgées à Arc-et-Senans (25)
Dans les pas de Raymond Lopez
Extrait du projet présenté
À Paris comme à Berlin ! Déjà, l’Atelier Téqui, en oeuvrant sur la dalle du Front de Seine, dans le 15e arron-dissement, avait croisé la figure du maître moderne Raymond Lopez. Un peu plus tard, à Berlin, lors d’un voyage d’agence, avec en mire des regards le Hansaviertel, vaste ensemble résidentiel érigé à l’occasion de l’exposition Interbau 1957, un immeuble de Raymond Lopez avait éveillé l’intérêt. Sa récente restauration – même imparfaite – venait illustrer l’avantage d’une approche respectueuse de son travail. Jusqu’alors, la plupart des ensembles résidentiels qu’il a réalisés avant sa mort prématurée en 1966 ont souvent fait l’objet d’interventions médiocres dans les années 1990 ou spectaculaires au début des années 2000 : aussi remarquable soit-elle, la tour du Bois-le-Prêtre réinventée par Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal et Frédéric Druot à Paris, ne laisse plus rien voir de l’esthétique voulue par Raymond Lopez. Aussi, à Aubervilliers, au sein d’un ensemble conçu par Raymond Lopez, l’Atelier Téqui renoue avec l’archéologie. Parmi les découvertes réalisées in situ, la plus intéressante concerne… des pâtes de verre ! Sous les enduits ajoutés au fil du temps, l’agence a retrouvé un matériau noble décliné dans plusieurs coloris : du bleu au rose, en passant par le vert. L’isolation par l’extérieur attendue par le maître d’ouvrage devenait, dans ces circonstances, inenvisageable. (…)

Réhabilitation des 503 logements collectifs sociaux des 2 tours Union et des 2 tours Cités à Aubervilliers (93) | ©Jeudi Wang
Une association pour une architecture aimable
Extrait de l’entretien avec les associés
Depuis 2023, l’Atelier Louis Téqui réunit cinq associés. Une révolution ? « Une évolution », corrige Louis Téqui. Il en va de la reconnaissance du travail des uns et des autres, mais aussi d’une suite logique. L’agence est un outil dont le fonctionnement doit être garanti. En jeu ? Un désir de transversalité au service d’une architecture aimable. Explications avec Louis Téqui, François Julla, Solenne Plet-Servant, Tristan Gaboriau, et Christelle Fidèle Pelissier.(…)
Logements neufs

©Ivan Mathie
2024
40 logements collectifs
ICF Habitat Atlantique
Bordeaux (33)
Équipement

©Jean-Baptiste Thiriet
2024
Centre de recherche sur l’Autonomie
Ivry-sur-Seine (94)
Sorbonne Université | EPAURIF
Auteur : Jean-Philippe Hugron
Visuel à la une : Transformation d’un ancien garage en 63 logements à Paris (11e) © Schnepp Renou
Retrouvez l’intégralité du Hors Série sur Atelier Téqui Architectes encarté dans le numéro d’Archistorm 131 daté mars – avril 2025 et séparemment en kiosques