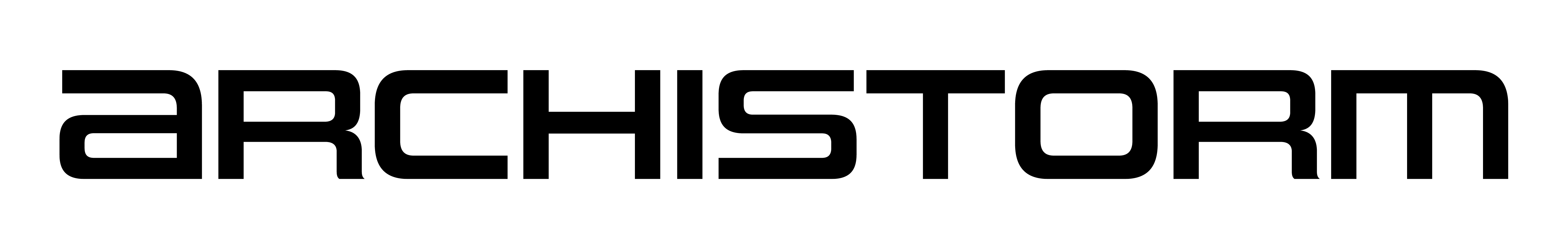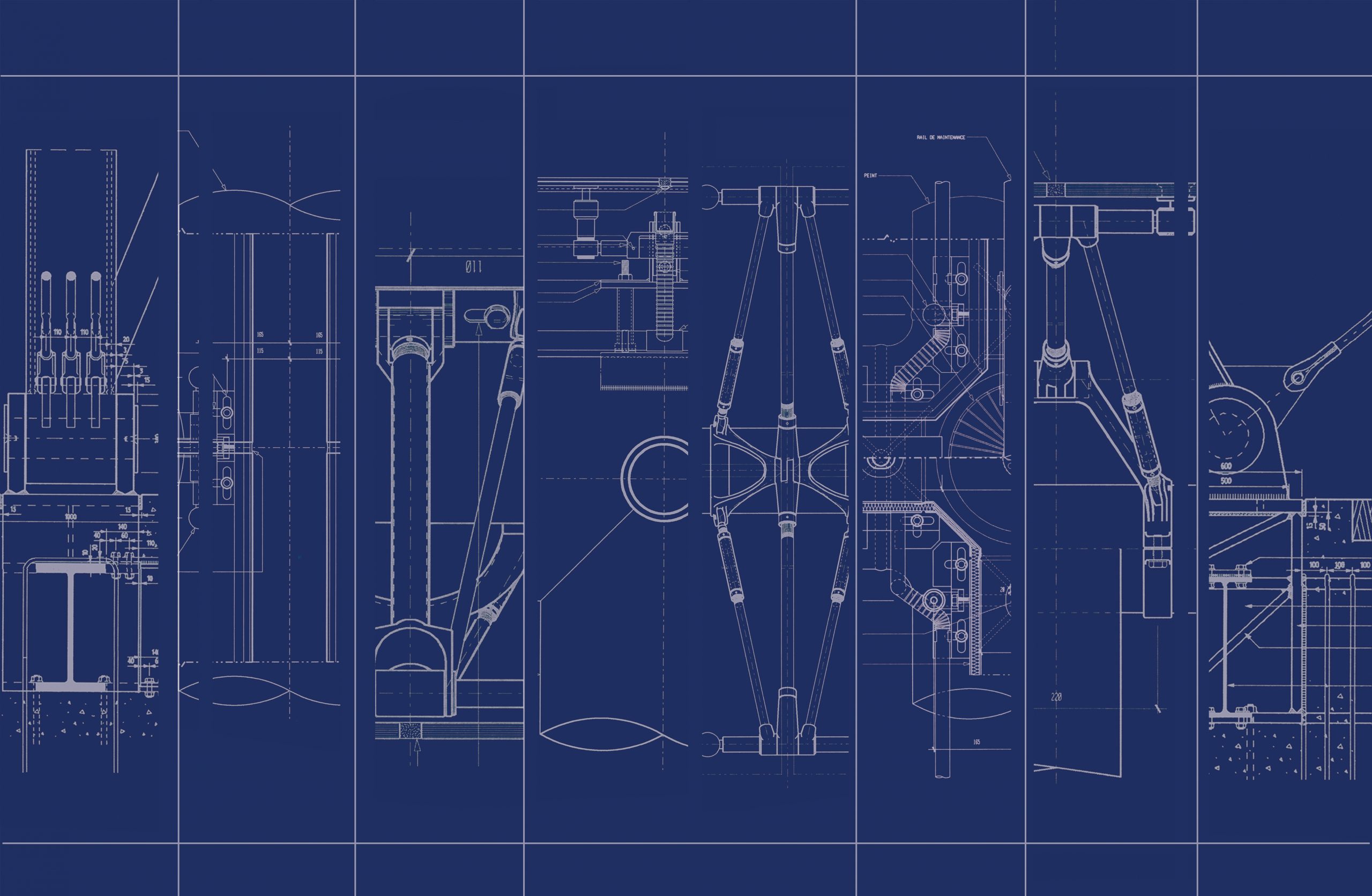Depuis sa fondation en 1986, l’agence Chatillon Architectes s’est imposée dans les domaines de la rénovation et de la restauration de monuments historiques. Mais pour François Chatillon, son fondateur et architecte en chef des monuments historiques, l’architecture ne se résume ni à la conservation ni au geste : il préfère parler de transformation, voire de réappropriation. Une posture discrète, respectueuse de l’existant, qui s’inspire du passé pour mieux répondre aux enjeux contemporains. Dans un secteur qui s’oriente enfin vers la réhabilitation plutôt que la démolition, la vision de l’agence prend ainsi tout son sens. Comprendre l’architecture, l’histoire du bâtiment tout autant que le programme qui s’y inscrit, pour faire cohabiter les deux dans une forme d’évidence.
Au fil des années, les projets de l’agence se sont multipliés et complexifiés, tout comme l’équipe, aujourd’hui forte d’une cinquantaine de collaborateurs. Née à Ferney-Voltaire, elle s’est implantée à Paris pour se rapprocher de ses chantiers, parmi lesquels le très attendu Grand Palais. Depuis 2019, Simon Chatillon, architecte HMONP, a rejoint la direction. Il poursuit la philosophie fondée par son père, tout en accompagnant le changement d’échelle de l’agence, désormais engagée sur des projets allant du patrimoine ancien à la construction neuve. Rencontre.
Une adéquation entre bâtiment et programme
La maîtrise de Chatillon Architectes dans la rénovation de bâtiments historiques n’est plus à démontrer. On lui doit notamment la restauration du musée Carnavalet à Paris et celle des Bains Municipaux de Strasbourg en 2021. Une véritable expertise que l’agence étend désormais sur des constructions neuves et parfois de grande envergure.
Comment appréhender alors un tel éventail de construction ? Par une méthodologie rigoureuse, que François Chatillon n’a cessé de faire évoluer, et qui anime désormais chaque membre de l’agence. L’ambition est claire : comprendre un bâtiment, saisir sa valeur, pour mieux l’inscrire dans le monde de demain. « Intervenir sur des bâtiments existants, porteurs d’une forte dimension historique, peut être intimidant », reconnaît Simon Chatillon. C’est pourquoi tout commence par une recherche et une compréhension approfondies sur l’architecture du lieu. Vient ensuite l’analyse critique du programme, afin d’éviter toute contradiction entre les usages projetés et l’esprit du bâtiment.
Ce processus permet alors d’agir avec plus de sensibilité. « Nous ne sommes pas dans ce que l’on pourrait qualifier de geste architectural », affirme François Chatillon, qui défend une vision humaniste de l’architecture. Le bâtiment existe, avec son histoire, son caractère. Il s’agit de l’accorder aux désirs contemporains, sans violence ni artifice. Un travail de précision qui ne laisse pas de place à une « signature » formelle, mais qui ouvre pourtant un véritable espace de création.
Dernier projet livré, le Quadrilatère de Beauvais reflète cette posture. Conçu dans les années 1960 par l’architecte André Hermant, ce bâtiment en béton s’inscrit dans un contraste radical avec son environnement immédiat – la cathédrale gothique et les remparts gallo-romains – mais aussi dans sa structure – une architecture horizontale face à la verticalité de la cathédrale. D’abord Galerie nationale de la tapisserie, puis centre d’art contemporain à partir de 2013, le bâtiment n’avait jamais été rénové. Il nécessitait une réhabilitation de fond, adaptée aux enjeux muséographiques actuels : accueil des publics, accessibilité, sécurité, scénographie.
Pour y répondre sans le dénaturer, l’agence a choisi des interventions mesurées mais décisives. L’une des plus visibles est la création d’un escalier monumental, mêlant volées de marches et de rampes, et ascenseur, pour assurer l’accessibilité de tous les niveaux. Une réponse à une contrainte technique majeure, traitée avec respect et cohérence. Cette attention du détail se prolonge dans le choix des matériaux et la volonté de fluidité. « Nous avons cherché à retrouver des éléments que l’on peut lire dans le musée, notamment la main courante en chêne que l’on retrouve tout au long des galeries. Nous l’avons reprise dans l’escalier pour créer une continuité », raconte Simon Chatillon.

S’inspirer de l’existant pour une architecture durable
Travailler sur le bâti ancien, c’est aussi pour l’agence l’opportunité d’aborder autrement la notion de durabilité. Si la démolition n’est plus une évidence dans la pratique architecturale contemporaine, le patrimoine a encore beaucoup à nous transmettre. Car la question ne se limite pas aux matériaux : la manière de construire est tout aussi essentielle. C’est là que la réversibilité entre en jeu.
Un bâtiment bien conçu est un bâtiment capable d’évoluer avec son temps. Il résiste, s’adapte et peut ainsi continuer à répondre aux besoins contemporains. Les monuments historiques en sont la preuve vivante, et doivent inspirer les architectes d’aujourd’hui. « L’architecture est une affaire de long terme. La durabilité est une question aussi bien de matériaux que de savoir-faire et de mise en oeuvre », souligne François Chatillon.
Le Grand Palais est un exemple emblématique de cette pensée. Vaste édifice de 77 000 m², il est aujourd’hui une vitrine de la scène culturelle parisienne et internationale. Mais cela n’a pas toujours été le cas. « À sa construction, on lui préférait le Petit Palais, plus académique. Le Grand Palais, lui, était pratique, mais mal aimé », raconte l’architecte. Il a même frôlé une démolition, André Malraux ayant envisagé d’y installer un musée d’art moderne conçu par Le Corbusier. Finalement sauvé, il n’avait cependant jamais connu de véritable restauration de fond.
Morcelé, cloisonné, le bâtiment a malgré tout pris une place centrale dans le paysage parisien. Et aujourd’hui, c’est toute une richesse architecturale que l’on redécouvre : une oeuvre malgré elle collective, conçue par trois architectes aux regards singuliers ; une complexité qui va au-delà de sa célèbre verrière de plus de 14 000 m² ; et surtout une structure extrêmement réversible. « C’est un bâtiment bien pensé qui a traversé le temps et qu’on doit aujourd’hui se réapproprier », répond François Chatillon. Car plus que d’une restauration, le projet mené par l’agence relève bien d’une réappropriation – sur le plan tant architectural que programmatique. Il s’agissait de répondre aux exigences contemporaines en termes d’accueil, de logistique, tout en repensant l’insertion du bâtiment dans son environnement, notamment son jardin. Un chantier d’envergure, qui a nécessité une méthode à la hauteur.

L’arrivée de Simon Chatillon dans l’agence en 2019 a marqué un tournant dans la structuration de l’agence. « Je suis arrivé à un moment où l’agence changeait d’échelle. Cela imposait de fait une nouvelle organisation », explique-t-il. Avec près de cinquante collaborateurs internes, l’agence a structuré sa méthodologie de travail pour s’adapter à l’ampleur croissante de son équipe et de ses projets. Le Grand Palais en a été un catalyseur, tout en restant fidèle à la pensée architecturale de l’agence.
En cinq ans, l’édifice a été transformé pour renouer avec son temps. Grâce à une exploration minutieuse des archives, des plans, des dessins, et à l’usage du BIM – pour la première fois à cette échelle sur un monument historique –, l’agence a pu modéliser l’ensemble du bâtiment, anticiper ses usages futurs et y glisser les dispositifs nécessaires : de nouveaux escaliers pour accéder dans les salles, un éclairage muséographique adapté, une nouvelle fluidité de circulations. Des réponses aux contraintes d’aujourd’hui, qui n’ont pas altéré l’esprit du lieu. L’opération redonne ainsi à voir la beauté de l’architecture, la cohérence de sa composition – désormais unifiée – et la générosité de ses espaces.
« Ce n’est pas de la rénovation, ni même une réhabilitation ou une restauration. C’est une réappropriation d’un bâtiment par la société contemporaine », conclut François Chatillon. Et là réside tout l’enjeu – la réussite – de l’agence : faire le lien entre l’histoire et l’avenir, pour que le patrimoine reste vivant durablement dans le tissu contemporain de la ville.
Par Aurore De Granier
Toutes les photographies sont de © Juan Jerez
— Retrouvez l’article dans Archistorm 134 daté septembre-octobre 2025