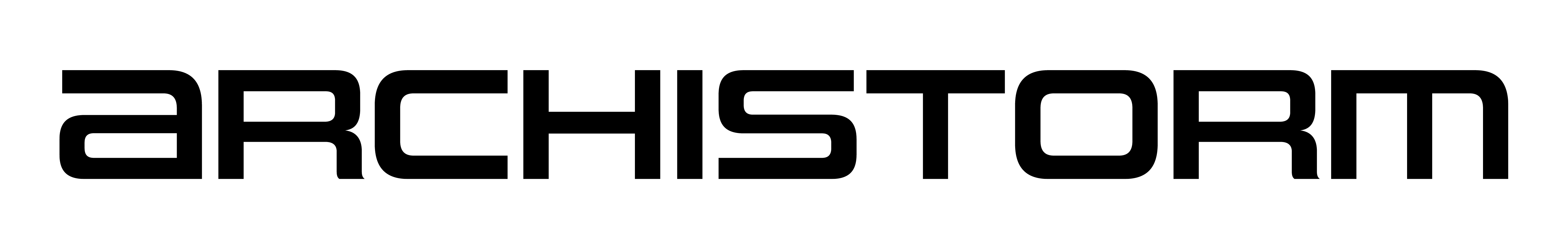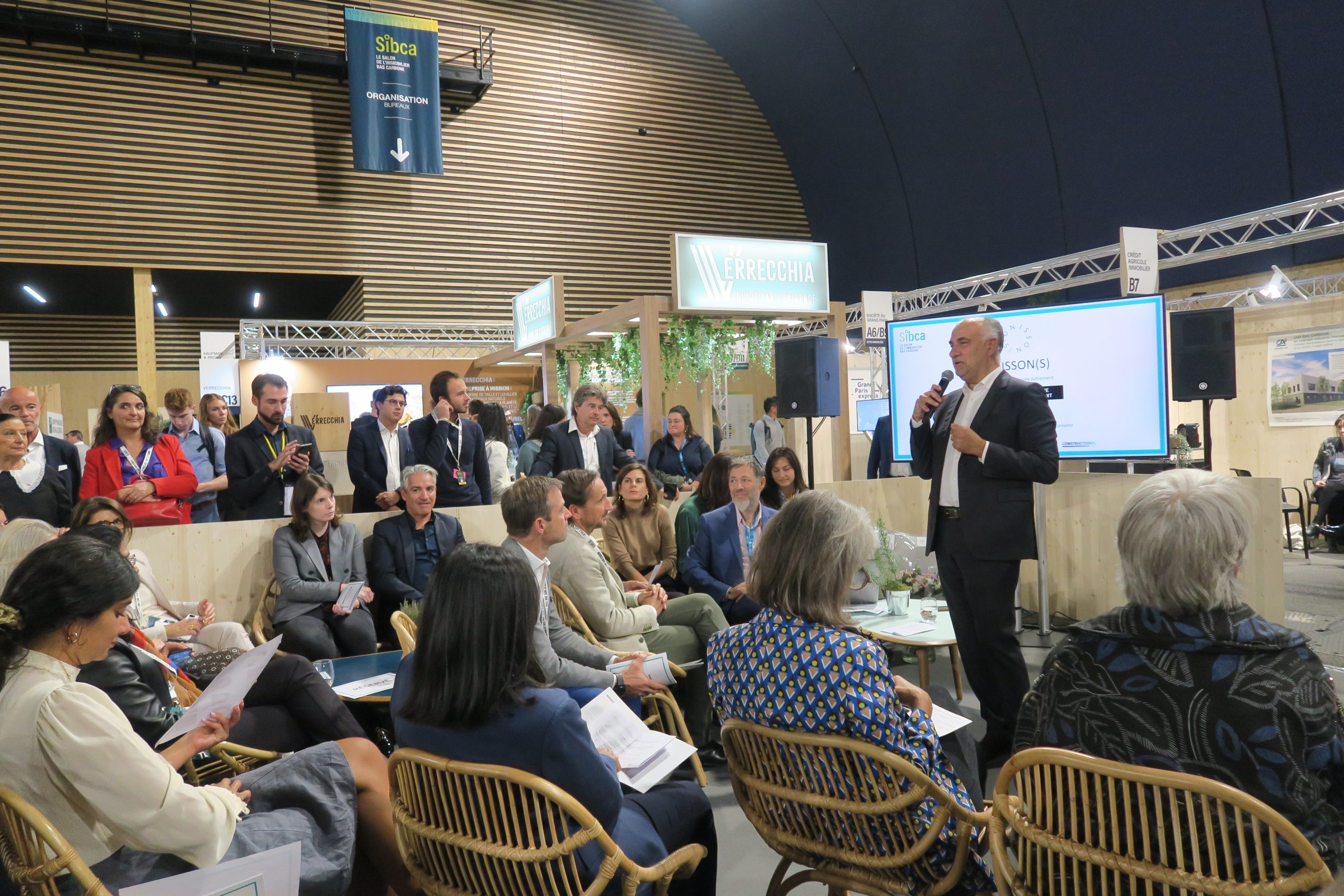Avant d’être le territoire en passe de retrouver une certaine unité grâce au projet urbain mené depuis 2001 suite aux études préliminaires menées dans les années quatre-vingt-dix, l’Île de Nantes était d’abord un archipel d’îlots sablonneux et marécageux, étroitement lié à son fleuve, la Loire, et aux usages que celui-ci entraînait dans son sillage. Des activités artisanales (tanneries et mégisseries) s’organisent à partir du XVIIe siècle, tandis qu’au centre se développe un faubourg autour de la première ligne de ponts. Des habitants s’y installent. L’activité devient industrielle au XIXe siècle, animant les lieux avec prospérité autour des usages portuaires. Les quartiers de Prairie-au-Duc et de Madeleine s’urbanisent ; la Gare de Nantes-État voit le jour en 1887. Les bras de la Loire (boires) seront peu à peu comblés au fil des siècles, jusqu’en 1945, modifiant la physionomie de la ville, laissant progressivement place à une île unique d’un point de vue géographique. Néanmoins, l’île demeure longtemps morcelée et composite dans la perception des Nantais, voire considérée comme une simple étape permettant de passer du nord au sud.

Quai François-Mitterand
Les prémices
Résumer l’histoire de l’Île de Nantes en une poignée de pages prend l’allure d’une véritable gageure. Une histoire qui entame sa quatrième décennie avec, aux manettes, sa troisième équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. Plonger dans ce récit, c’est mesurer le nombre incroyable de personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à cette aventure. Puisqu’il faut bien un début à défaut d’une fin, et même si l’on s’inscrit toujours dans une histoire au long cours, actons qu’il fut éminemment politique et incarné par une personnalité indissociable de la ville de Nantes, Jean-Marc Ayrault, lequel a, pour ce faire, su parfaitement s’entourer.
Étude urbaine exploratoire et prise de site
Pour orchestrer cette mutation, il fallait une personne capable d’en comprendre toutes les subtilités, même les plus cachées. Dans la foulée de son élection, Jean-Marc Ayrault fait, dans un premier temps, appel à Dominique Perrault et à François Grether pour mener une « étude urbaine exploratoire » sur le futur de ce qui devient officiellement à cette époque « l’Île de Nantes ». Un choix politique, certes guidé par le marketing territorial, mais redoutablement efficace puisque dénué d’artificialité. À cet ensemble morcelé, mal connu, peu ou pas fréquenté des Nantais, succède l’affirmation d’une île réunifiée, sans d’autre promesse trop présomptueuse que celle d’exprimer haut et fort sa géographie intrinsèque.
Le Plan-Guide d’Alexandre Chemetoff
Si le premier mandat (1989-1995) de Jean-Marc Ayrault voit le développement du projet de l’Île de Nantes (1995-2001), le deuxième est marqué par le passage à l’action. Suite aux études préliminaires menées par Dominique Perrault et François Grether, un marché de définition est lancé en 1998 par la Communauté Urbaine de Nantes pour désigner l’équipe qui conduira la première phase de la transformation de l’île.
En 1999, l’équipe d’Alexandre Chemetoff et Jean-Louis Berthomieu est retenue, face à d’autres concurrents. C’est ainsi que débute une mission de maîtrise d’œuvre et la création de l’Atelier de l’Île de Nantes, dirigé par Patrick Henry.
À Nantes, Alexandre Chemetoff développe son Plan-Guide, un système itératif où chaque projet nourrit le suivant, en rupture avec les masterplans traditionnels. Ce Plan-Guide se caractérise par des allers-retours constants entre site et programme, une approche itérative et non directive, acceptant l’indétermination : un projet en mouvement qui s’inscrit dans les principes d’un développement urbain durable.
Chemetoff analyse le site à partir du paysage, préservant ses qualités et sa mémoire, et donnant une direction d’intervention sur l’ensemble du territoire. Son urbanisme propose plutôt qu’il n’impose, orientant sans dévoyer la réalité.
Au début des années 2000, le volet opérationnel du projet débute avec la création de la Samoa, dirigée par Laurent Théry. Cette société d’économie mixte pilote ce qui se fait sur l’Île, encadrant les différentes opérations. Jean-Marc Ayrault, Laurent Théry et Alexandre Chemetoff forment un trio prospère partageant un certain nombre de convictions.
En 2003, face à la ville historique, s’ouvre la promenade du quai François-Mitterrand, illustrant la stratégie forte d’Alexandre Chemetoff d’un projet urbain avant tout fondé sur l’espace public.

Oeuvre « L’absence », de l’Atelier Van Lieshout, 2009
Les Machines de l’Île : une vitrine culturelle
Se pose en parallèle du projet urbain la question d’un équipement culturel d’envergure dans cette partie ouest de l’île. François Delarozière, venu de Toulouse, propose à Jean-Marc Ayrault de construire ses Machines, sortes de sculptures urbaines, sur le territoire de l’Île de Nantes alors en pleine mutation : le maire de Nantes est aussi séduit que convaincu, pressentant peut-être ce qui deviendra le symbole de cette transformation. Tous ensemble, ils vont créer les Machines de l’Île de Nantes en se retrouvant autour d’une idée forte : transformer les anciennes Nefs Dubigeon en un lieu de production ouvert au public, où le processus de fabrication se dévoile comme au temps des chantiers navals.
Vidées et désossées, les structures sont conservées formant de grands parapluies urbains. Ces anciennes nefs, c’est aussi « la maison » de l’Éléphant de François Delarozière et Pierre Orefice, symbole de cette transformation. L’animal est devenu un autre emblème au même titre que la grue jaune, classée Monument Historique en 2005. Si les Nefs représentent la rencontre entre l’espace public et des lieux d’expérimentations programmatiques et artistiques, les Machines vont révéler la puissance du lieu.
Qui, depuis leur inauguration en 2007, pourrait aujourd’hui imaginer ce Parc de Chantiers sans les Machines de l’Île ? Ces grandes halles industrielles qui abritent les Machines de l’Île se sont rapidement imposées comme l’image culturelle de l’Île de Nantes. Ce haut lieu de promenade et de tourisme culturel, le Parc des Chantiers où trône entre autres Le Carrousel des Marins, installé plus tard, est une ode à l’espace public non codifié, ouvert et librement appropriable.
Dans la continuité des Nefs Dubigeon, la réhabilitation des Halles Alstom édifiées en 1850 s’inscrit dans cette même volonté d’utiliser l’héritage industriel de l’île pour écrire son avenir. Rachetées par la municipalité, elles deviendront le centre de gravité du Quartier de la Création, catalysant les énergies culturelles et créatives.
2007, une année phare pour l’Île de Nantes
Avec l’inauguration des Machines de l’Île en 2007, le génie du lieu, expression si souvent galvaudée, prend à Nantes tout son sens. Un projet culturel, tête de gondole de la métamorphose du territoire, aimant à touristes, aussi puissant qu’un musée institutionnel mais bien plus libre dans sa forme : un équipement non pas parachuté artificiellement, mais qui puise sa substantifique moelle in situ. Outre les Nefs, d’autres livraisons emblématiques vont voir le jour au cours de cette année marquante pour l’histoire de l’Île de Nantes. On construit un certain nombre de logements pour absorber la croissance démographique de Nantes. Sur le Quai François-Mitterrand à l’ouest, ANMA inaugure « Habiter les Quais », la première opération de logements de l’agence pour le promoteur ING. Juste à côté, Hervé Beaudoin livre quant à lui un bâtiment devenu emblématique de l’île grâce à ses larges balcons en proue sur la Loire : DY25 Rive Gauche. À l’est, le bâtiment Playtime signé Tetrarc illustre la volonté de mixité en regroupant un programme diversifié de logements, une école de sport et une école de la deuxième chance. À la pointe ouest, le Hangar à bananes, soit 7 800 m² désaffectés, est ressuscité par l’architecte Michel Roulleau sur le Quai des Antilles dans la continuité du Parc des Chantiers. Cette ancienne friche, où étaient déchargées les marchandises en provenance des colonies, a conservé son caractère portuaire et abrite désormais des bars, des restaurants, une discothèque, un théâtre mais aussi le centre d’art / librairie HAB Galerie. Cette résurrection fut emmenée par Jean Blaise à l’occasion de sa première Biennale Estuaire en 2007. Les Machines, son éléphant, désormais indissociables de l’image de la ville, sont sous les feux des projecteurs. C’est ce qui permet à Nantes de devenir une destination culturelle alors qu’elle peinait jusqu’alors à attirer les touristes, faute d’une offre suffisamment attractive.
L’École nationale supérieure d’architecture, premier jalon du Quartier de la Création
En 2009, l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes signée Lacaton & Vassal accueille ses premiers étudiants au terme d’un déménagement mouvementé de la rue Massenet au nord de la ville à l’ouest de l’Île de Nantes. Offrant un véritable contrepoint au Palais de Justice, ce bâtiment outil tutoie la Loire sans ambages. Pour remporter le concours, les architectes ont tout simplement l’audace de doubler la surface demandée par le programme. Une manière d’offrir des espaces supplémentaires, intermédiaires, non déterminés et ouverts à l’appropriation. Pour ce faire, les matériaux et la structure sont bruts, choisis pour l’économie de moyens qu’ils autorisent. Au moment de son transfert sur l’île, l’établissement était alors dirigé par Philippe Bataille. Patrick Bouchain accompagnera la gestation complexe de ce déménagement que Laurent Théry et la Samoa vont mettre en œuvre. Entre les deux bâtiments qui la composent, Jean Blaise propose d’installer l’Absence, une œuvre pérenne d’Estuaire signée de Joep Van Lieshout qui n’est autre que le 1 % artistique de l’école d’architecture.

Quartier Prairie-au-Duc
Et à l’est ?
La success story de l’Île de Nantes est souvent focalisée sur sa partie ouest – son tribunal, son école d’architecture, ses Machines –, si bien que l’on oublie souvent que l’est s’est lui aussi largement métamorphosé. Dans cette première phase, il ne faut donc pas occulter Beaulieu. En 2008, Patrick Bouchain offre une seconde vie au centre commercial Beaulieu dont on avait du mal à imaginer qu’il serait entraîné dans le sillage de la transformation de l’Île de Nantes. Édifié au mitan des années soixante-dix, il s’est transformé en profondeur pour devenir un lieu ouvert sur la ville. Ici encore, plutôt que de céder aux sirènes de la démolition, Alexandre Chemetoff a défendu la réhabilitation, toujours animé par la conviction de composer avec ce qui est déjà là.
Vers une nouvelle étape
La fin de l’ère Alexandre Chemetoff a commencé à poindre sur fond de désaccord sur l’implantation du futur CHU même si son contrat touchait à sa fin. En 2010, Jean-Luc Charles succède à Laurent Théry en tant que directeur général de la Samoa. Ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault de 2005 à 2010, il va piloter cette nouvelle étape de l’Île de Nantes. En jeu, le futur écoquartier de Prairie-au-Duc au sud du Parc des Chantiers, le déménagement du CHU et le développement du Quartier de la Création façonné par la connaissance, l’innovation et la culture. Il s’agit, entre autres, de conforter l’importance des industries culturelles et créatives pour prolonger la dynamique enclenchée par les Nefs et l’École nationale supérieure d’architecture.
(…)
Texte : Soizick Angomard, Frédérique Renaudie, Gabriel Ehret
Photos : Juan Jerez
— Retrouvez l’intégralité de l’article dans Archistorm 126 daté mai – juin 2024