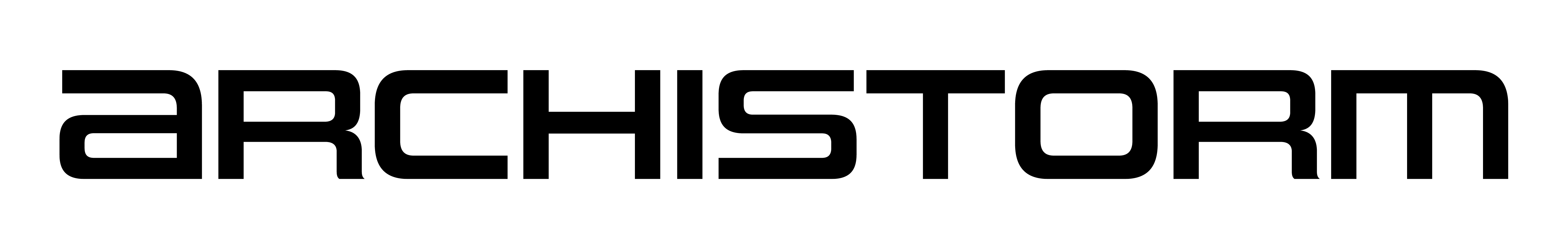Racheté il y a vingt ans par Audemars Piguet, l’Hôtel des Horlogers vient d’être reconstruit par l’agence danoise BIG et sa consœur helvétique CCHE, déjà co-auteurs de la très récente rénovation-extension en Musée Atelier de la manufacture horlogère voisine, berceau de la célèbre marque de luxe. L’aménagement proposé par le Lyonnais Pierre Minassian est tout aussi atypique et inspiré que sa typologie architecturale.
Chronologie
Au pied de la partie la plus montagneuse de l’Arc jurassien la séparant de la France, la vallée de Joux avec son lac du même nom concentre depuis le XVIIIe siècle bon nombre de fermes horlogères ayant concouru à la renommée mondiale du Pays de Vaud et de la Suisse romande en matière d’horlogerie. Antoine LeCoultre y crée dès 1833 son atelier au Sentier, Jules-Louis Audemars, bientôt rejoint par Edward-Auguste Piguet, y ouvre le sien en 1875 au Brassus.
Dix-huit ans plus tôt, l’Hôtel de France avait ouvert ses portes dans ce hameau de la commune du Chenit, le service de Poste entre la France et Genève y faisant un relai. Reliant deux pôles horlogers helvètes majeurs, la route fut d’ailleurs baptisée Chemin des Horlogers ! Ravagé par un incendie en 1982, l’établissement reconstruit 24 mois plus tard avait conquis sa quatrième étoile. L’ayant racheté en 2003 (trois ans après sa cession au groupe de luxe Richemont), la firme Audemars Piguet décida en 2016 de le rebâtir afin que sa requalification puisse le mettre sur la même orbite que le Musée Atelier venu se greffer en 2020 à la manufacture, elle-même entièrement rénovée. Pour incarner l’engagement de la Manufacture à perpétuer la Haute Horlogerie dans la vallée de Joux et au-delà, cet espace d’arts vivants et de rencontres a pris la forme, sous le crayon de Bjarke Ingels, d’une spirale de verre sortant de terre pour supporter un toit d’acier de 470 tonnes. Son audace technologique fait référence aux « complications » caractérisant les innovations des « garde-temps » ayant fait la renommée de la marque.
Manipulations morphologiques
La démolition intégrale de l’ancien hôtel a donné lieu à un chantier de
dépollution complète du site. Cette tabula rasa ne pouvait déplaire à l’architecte scandinave dont les réalisations chamboulent – avec délectation – les canons classiques de sa discipline. Depuis deux décennies, il n’a de cesse de faire pivoter, vriller, basculer, translater, étager, incurver, dilater, compresser, évider, pixelliser… les volumes de ses édifices, modelant ainsi au fil du temps une architectonique identitaire tout à la fois pragmatique
et utopique.
Implanté dans le talweg du vallon, le nouvel hôtel ne laisse émerger en façade sur la rue principale traversant le Brassus que les deux étages supérieurs de ses cinq niveaux. « Grâce à son concept architectural avant-gardiste, le bâtiment suit la topographie de la vallée et épouse le paysage pour plonger les visiteurs dans l’environnement naturel du lieu, explique l’agence suisse. La structure est constituée de dalles qui s’avancent en zigzags vers la vallée et s’inclinent légèrement pour embrasser le relief et créer un chemin continu dans la pente. Ce concept appréhende le site comme une succession de crêtes montagneuses descendant la colline, où les blocs du bâtiment deviennent une série de bermes bordées d’arbres et de végétaux variés. »
Si ce dispositif prive les cinquante chambres de balcons, il leur offre l’intimité nécessaire par rapport au sentier extérieur via ses parterres triangulaires, de sublimes vues intégrales sur la vallée et la forêt du Risoud sur le versant opposé, d’inattendus puits de lumière dans les salles de bain des douze suites. Difficile d’imaginer l’ensemble des contraintes à résoudre pour fluidifier son fonctionnement général, à commencer par les circulations en pente douce distribuant les habitations. Bar, restaurants, fitness, espace de séminaire investissent ingénieusement les pignons. Le parement de mélèze grisé de la devanture côté village alterne bardage vertical, claustra horizontal et marquise.

© Christophe Voisin
AUM sweet home
Lorsque Pierre Minassian s’est vu confier l’aménagement de l’hôtel – sa construction étant achevée depuis plusieurs mois –, celui-ci n’était encore qu’une coquille vide. « Notre projet d’aménagement a cherché à exploiter tout le potentiel d’un bâtiment en béton brut à la structure remarquable qui s’inscrit dans un site fortement marqué sur les plans topographique et géologique, afin de l’articuler à un concept d’expérience hôtelière unique et emblématique dont tous les détails ont été pensés, qu’il s’agisse de lumière, d’ergonomie, d’ambiance, d’acoustique, de confort ou de bien-être. Les produits standard ont été écartés afin de trouver les formes et les matériaux justes en accord avec le lieu pour une composition architecturale vraie. »
Le Jura et la vallée de Joux ont inspiré au concepteur un univers onirique. Évoquant la proximité du lac, une grande vasque précède l’entrée dans l’impressionnant lobby dont la hauteur sous plafond se dilate au gré des emmarchements et des plans inclinés qui le sculptent. D’étranges troncs d’arbres écorcés inversés s’échappent du plancher haut tel un système racinaire, de longilignes luminaires fongiformes en acier douchent l’oblongue banquette en strates de chêne clair multiplis qui se mue en banque d’accueil. En poursuivant l’ascension, le client découvre un bar cathédral dont la marqueterie du comptoir s’anime de lignes de crêtes que suggèrent également les nœuds des cordages habillant ses murs, tandis que les suspensions en résine semblent évoquer des montagnes évidées ou des lacs renversés. Un niveau en dessous, ces dernières éclairent aussi le restaurant à l’ambiance plus glaciaire – sans être pour autant glaciale – avec ses enrochements de marbre super white Calacatta bouchardés façon glacier, ses banquettes immaculées ressemblant à des moraines, ou encore son sol en granit. De graciles lampadaires disséminent ici et là leurs abat-jour noirs très fifties.
Imaginées comme autant de cadres gradinés depuis la vallée, les cinquante chambres déclinent une identité commune : refends en béton brut, parquet, faux-plafond et mobilier bois, quatre pétales en Corian® en guise de plafonniers, portes de penderies en panneaux acoustiques micro-
perforés imprimés cimes, sérigraphie de carte topographique sur les miroirs habillant les salles d’eau. Les suites profitent des impostes vitrées en façade générées par le gradinage pour éclairer naturellement leurs salle à manger et salle de bain cathédrales bien qu’étant en fond de volume.
Un bien beau voyage dans le Temps !
Par : Lionel Blaisse
Visuel : © Maris Mezulis
— Retrouvez l’article dans Archistorm 130 daté janvier – février 2025