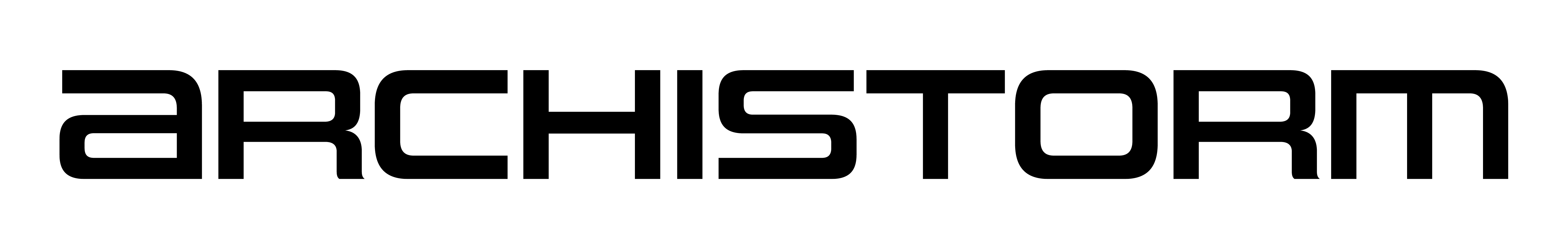Donner un avenir à son histoire. La formule prend des allures de symbole quand il s’agit de retracer le destin de l’hôtel particulier Bouchu dit d’Esterno, joyau du XVIIe siècle entré dans le patrimoine de la Ville de Dijon en 1884, qui vient d’être entièrement réhabilité en vertu de la décision unanime des 50 États membres de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) de valider la proposition faite par la France de transférer leur siège de Paris à Dijon.
La fabrique du projet
Présente à Paris depuis sa fondation en 1924, l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin s’installe dans le cœur historique de Dijon pour ouvrir son deuxième centenaire, dans l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno du XVIIe siècle restauré par la Ville. L’OIV est une organisation stratégique intergouvernementale en charge d’harmoniser le secteur mondial de la vigne, du raisin et du vin. Elle participe à relever les défis environnementaux et économiques que le monde vitivinicole doit relever dans le futur pour offrir aux 50 pays membres, producteurs et consommateurs, des informations qui permettent le développement des réglementations, la réduction des obstacles au commerce, la promotion d’une production durable et la protection des consommateurs.
À la recherche d’un nouveau siège plus vaste, adapté à ses besoins, à ses missions, à son ambition et à son rayonnement, confrontée à la pression foncière de la capitale, l’OIV s’en remet à la France, l’État hôte en vertu d’un traité international, pour lui proposer un lieu prestigieux. Le Bordelais, la Bourgogne, la Champagne concourent, plus précisément Bordeaux, Dijon, Reims qui offrent tous des lieux d’exception. Sur une analyse argumentée du comité de pilotage technique – l’OIV et trois ministères : Finances, Agriculture, Affaires étrangères –, le gouvernement français propose que Dijon accueille le siège de l’OIV dans l’hôtel particulier Bouchu dit d’Esterno en engageant les études pour sa réhabilitation, proposition ratifiée à l’unanimité des 50 États membres de l’OIV.
« La nouvelle qualification de l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno comme siège de l’OIV vise plus que jamais à promouvoir l’héritage culturel de la vigne et du vin et à doter ses acteurs publics d’un outil innovant, favorisant l’éducation, la connaissance et le dialogue universels. »
— François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole
Dans le respect des siècles passés
Préalable obligatoire pour relever le défi posé par l’Hôtel Bouchu dit
d’Esterno : associer des architectes qui partagent une culture, des méthodes de travail et une longue expérience. Fabien Drubigny, architecte du patrimoine, de Fabien Drubigny architecte, et Bernard Quirot de BQ+A répondent point pour point à ce prérequis au nom d’une complicité fondée sur des collaborations antérieures au contexte patrimonial prédominant : la création de la Maison de santé de Vézelay dans l’Yonne, Équerre d’argent 2015, et la réhabilitation-restructuration de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. L’autre force réside dans la constitution d’une équipe familière de spécialistes uniquement régionaux en réponse à la réactivité nécessaire au suivi du chantier et à la tenue des délais.
Les partis pris de la restauration sont multiples avec à l’intérieur le rétablissement des volumes intérieurs – décloisonnement des espaces, aménagements de salles et de bureaux, attention portée aux circulations avec prise en compte des personnes à mobilité réduite, etc. –, et, à l’extérieur, la redécouverte de la silhouette d’époque classique et le réaménagement du jardin. Côté cour, l’ambition passe par redonner l’élévation telle qu’elle devait apparaître au XVIIe siècle avec ses hautes toitures d’ardoises aux faîtages décorés. Côté jardin, la façade très modifiée retrouve son état de la seconde moitié du XVIIIe siècle avec la suppression de la galerie construite en 1929 et la mise en place d’un enduit ocre-jaune, en vogue à l’époque.
Sur un plan concret, la conception entend limiter les interventions lourdes sur le patrimoine, tandis que la bonne connaissance des services
patrimoniaux régionaux – archéologie, bâtiments de France, monuments historiques – est une source de fluidité dans les obligatoires négociations. Enfin, l’équipe de maîtrise d’œuvre défend « qu’un bon projet a pour condition des échanges fréquents avec la maîtrise d’ouvrage et les utilisateurs » et se dit « prête à le construire ensemble ».
Plus que pour d’autres projets, le parti pris initial couvre l’architecture, le patrimoine, le fonctionnel et la technique intimement liés, respect d’un hôtel particulier oblige. Construire des salles techniquement exigeantes plutôt que les insérer dans le bâti existant limite les interventions sur le bâti historique ; ce qui réduit le temps de chantier et les coûts, et facilite l’acceptation du projet par la tutelle des Monuments historiques et des Bâtiments de France. La démolition de l’avancée construite en béton armé en 1929 par Georges Parisot en façade sud sur jardin restitue le bâti originel, clarifie les fonctions et renforce la luminosité des salons. Cette façade arrière principale retrouve son lustre, les salons leur disposition d’origine, espace de transition entre les deux ailes et large accès sur la terrasse nouvelle.
Habiller de façade bois les anciennes cours intérieures de l’ex-crèche accolée au corps principal de l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno relève de la cohérence avec les constructions à colombage du centre historique de Dijon. Se joue aussi ici un effet de contraste avec le monument en pierre, sans négliger la qualité et la rapidité que procure la fabrication en atelier de la structure et des façades.Les combles du bâti historique restent vierges de toute fonction : pour dépasser les 8 m, ils devraient alors répondre à nombre de contraintes réglementaires avec le risque d’oblitérer le respect du patrimoine, sans parler des délais et des coûts.
Un passage en sous-sol facilite l’organisation des réceptions et permet la discrétion des livraisons au niveau de l’office et du restaurant. La cour sur la rue Monge retrouve son statut de cour d’honneur. Les circulations verticales bénéficient de la conservation de petits escaliers situés dans les extensions du XVIIIe siècle et de l’escalier hélicoïdal plus difficile à dater, ainsi que de la construction d’un escalier circulaire dans la travée centrale du corps de bâtiment principal et d’un ascenseur. La décoration historique des pièces en rez-de-chaussée, largement reprise et repeinte au fil du temps, est simplement conservée après un nettoyage expert. Enfin, une nouvelle construction s’intègre sous la terrasse entre les deux ailes en retour côté jardin pour héberger un amphithéâtre à éclairage zénithal.
La conception, qualifiée de disruptive par les architectes familiers de ce type de pas de côté, permet au bâtiment d’imposer sa géométrie en H avec la cour d’honneur, très parisienne dans sa mise en scène, la pureté de ses façades et sa relation avec le jardin. Un choix fort d’une efficiente et respectueuse originalité qui remet en pleine lumière cet hôtel remarquable.
Le quartier Monge requalifié dans le même élan
Depuis le début des années 2000, la Ville a engagé un plan d’aménagement et d’apaisement de l’espace public qui, porté par la piétonisation des emblématiques place de la Libération et rue de la Liberté ainsi que par le retour du tramway, irrigue presque tout le site patrimonial remarquable (ex-secteur sauvegardé). Co-conçue par l’agence Stoa et les services Urbanisme et Espace public de Dijon métropole, la requalification de l’axe Monge-Bossuet en 2024 vient comme conclure cette stratégie vertueuse d’un meilleur partage de la rue, tout en offrant un écrin embelli à l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno restauré.
Un point de départ, la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à la porte d’Ouche, un point d’arrivée, la rue de la Liberté, des éléments structurants, la placette Crébillon, le parvis Saint-Jean et la place Bossuet. Clin d’œil historique vitivinicole, ce parvis face au siège de l’OIV n’est autre que le lieu où se tenait au Moyen Âge l’Estape, alors le marché au vin, en gros et en détail le plus important en Europe, contribution au rayonnement du patrimoine viticole de Dijon et de la Bourgogne.
Le chantier Monge-Bossuet cause de fortes sujétions aux transports publics et privés, riverains et commerçants, et à la collecte des ordures ménagères. Sans parler de l’accès au chantier de restauration de l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno. Cet embellissement d’une grande sobriété minérale favorise le réemploi des matériaux, entraîne l’apaisement de l’espace public, optimise les déplacements cycles et piétons avec un élargissement des trottoirs conjoint à la neutralisation de 27 places de stationnement. Parfois interrompue pendant les travaux, la circulation automobile est désormais réduite à une file place Bossuet ; elle préserve l’accès au parking Dauphine, le libre passage des bus du réseau Divia et la traversée sud-nord du centre-ville en direction de la gare. L’aménagement conserve également neuf places de livraison et trois places pour les personnes à mobilité réduite.
Cependant, nul projet urbain contemporain sans attention portée à la lutte contre l’effet d’îlot de chaleur – qui plus est dans le cœur historique par nature très minéral de Dijon –, avec la végétalisation liée à la plantation d’environ 70 arbres et à la désimperméabilisation de la place Bossuet. Plus d’un hectare d’espace public est aujourd’hui infiltré directement à la source.

© François Weckerle / Ville de Dijon
Une rencontre entre une façade et un jardin
Une symétrie axée sur la façade, une broderie végétale composée de massifs et bordée par des allées, un cadre fermé par un rideau haut de charmilles résument la conception du jardin de l’Hôtel Bouchu dit d’Esterno.
Confrontée à l’impossibilité de reproduire l’histoire, l’intervention végétale, largement anticipée dès le démarrage du chantier, privilégie de nouvelles perspectives fondées sur la rencontre entre la façade d’un hôtel du XVIIe siècle et un jardin. La symétrie centrale, simple, axée sur le bâtiment, installe le jardin clos de murs comme une pièce supplémentaire, construction horizontale évidente à la végétation étagée commandée par l’ordre vertical architectural.
Cet axe traverse une broderie végétale composée de quatre massifs – ils comptent pour autant d’espaces de réception potentiels – et bordée d’allées de terre-pierre. Un dialogue contrasté s’organise entre une succession de haies d’osmanthes taillées – un arbuste persistant et parfumé – et une collection de plantes vivaces. Cet index végétal renvoie aux conditions de vie de la vigne. Un rideau haut de charmilles percé de contre-allées ferme la composition générale. Contourner cette quasi-marquise aboutit à la chambre des ifs dédiée au stationnement et à une aire de livraison sans confrontation avec les parties piétonnes et les proportions du jardin d’origine. Des tapis végétalisés de pavés en comblanchien – la limitation des zones pavées préserve l’entière perméabilité du site et lutte contre les îlots de chaleur – scandent la géométrie dessinée.
Ces seuils marquent les entrées et les séquences majeures de la composition. Ce plan anticipe d’évidentes contraintes pour éviter les affouillements, cause de retard dans le chantier, préserver des atteintes le système racinaire des arbres en place et préserver les vestiges archéologiques.
Dans la compréhension du bouleversement climatique, une attention particulière se porte sur la facilité d’entretien, la persistance et la résistance à la sécheresse synonyme de la sobriété de l’arrosage une fois les plantations exécutées, voire de l’absence d’arrosage avec des plantes vivaces ad hoc et une végétation xérophyte particulièrement résistante à l’aridité. Autre signe des temps, les plantes spontanées sont les bienvenues pour participer à la composition générale et amener de la diversité. La floraison odoriférante du jardin s’étale de février à septembre avec son apogée en juin-juillet. Enfin, en cas de pluies abondantes, l’assise du jardin entièrement perméable, l’absence totale d’élément en béton et un système de pentes invisibles dans les massifs garantissent la récupération de l’eau sans dommage.
Entretien avec Luigi Moio, président de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Il y a peu d’exemples qui voient une organisation intergouvernementale quitter Paris. Pourquoi une telle décision ?
À la différence d’autres organisations intergouvernementales, l’OIV n’a jamais été propriétaire de son siège et a donc été tributaire d’un changement de destination de l’immeuble qui abritait son siège rue d’Aguesseau à Paris depuis un quart de siècle. Cette éviction nous a contraints à quitter en 2019 un hôtel particulier avec salles de réception, jardin et caves pour des volumes classiques de bureaux qui ne correspondaient plus aux besoins ni au statut de l’OIV. Pau Roca, directeur général de l’OIV de 2019 à 2023, a donc sollicité la France, État hôte du siège, afin qu’une solution pérenne et adaptée soit proposée aux États membres de l’OIV pour les cent ans de l’Organisation en 2024.
Entretien Fabien Drubigny, fondateur de Fabien Drubigny architecte
Comment la collaboration Drubigny / BQ+A est-elle née ? Pour quelles raisons avez-vous répondu ensemble au concours de l’OIV ?
Notre collaboration s’est faite de manière naturelle et spontanée. J’ai collaboré de 2010 à 2015 avec Bernard (Quirot) et Alexandre (Lenoble) dans leur agence de Pesmes et j’y ai, pour ainsi dire, appris le métier. Au moment de l’appel à concours, la SPLAAD réclamait que l’architecte mandataire soit architecte du patrimoine, ce que je suis depuis 2016.
Nous sommes un petit bureau et nous n’étions pas, à nous seuls, armés pour répondre à une telle opération. L’agence BQ+A était, elle, rodée à cet exercice et à cette échelle de projet. Elle avait notamment, dans ses références, la restructuration des locaux de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, abritée dans deux très beaux hôtels particuliers classés, et à laquelle j’avais activement participé lors de mon passage à Pesmes.
Notre candidature commune coulait de source. Elle fut même, d’une certaine manière, un retour aux sources. Elle fut surtout l’occasion de retrouvailles amicales et joyeuses.
Entretien Sébastien Fleury, P.-D.G. de l’entreprise ADECO Menuiserie en Monument Historique
Que retenez-vous de votre intervention à l’OIV ?
En avril 2023, nous avons eu l’heureuse surprise d’être retenus pour la réalisation du lot menuiseries extérieures bois patrimoine. Cette prestation inclut la restauration de menuiseries – trois fenêtres type XVIIe de la cour d’honneur, qui, après étude, sont le modèle de fabrication pour toutes les menuiseries XVIIe du chantier, la porte cochère et la porte d’entrée de l’ancienne crèche, les deux impostes bois et vitrées des deux portes du perron – et la fabrication de menuiseries neuves – fenêtres, portes-fenêtres et volets intérieurs de types XVIIe et XVIIIe, portes d’écuries, porte d’entrée, portes à lames verticales, l’ensemble intégrant trois châssis de désenfumage, la fourniture et la pose de stores à projection.
Fiche technique
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Dijon
Mandataire du maître d’ouvrage : SPLAAD
Maîtrise d’œuvre : Fabien Drubigny architecte, mandataire, BQ+A, associé
Utilisateur : OIV
Entreprises (liste non exhaustive) : Adeco 25, DROZ Électricité, GCBAT Côte d’Or
Par : Pierre Delohen
Visuel à la une : © François Weckerle / Ville de Dijon
— Retrouvez l’article dans Archistorm 130 daté janvier – février 2025